La
génisse et le pythagoricien
2002
c
o m p a g n i e t f 2 , j e a n - f r a n ç
o i s p e y r e t
h t t p : / / w w w . t f 2 . a s s o
. f r
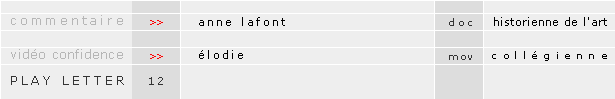
|
télécharger
les documents :
sur mac, activer la touche "alt" en cliquant sur les liens
ci-dessus et choisir la commande "télécharger
le lien sur le disque". sur PC, clic droit et choisir la commande
"enregistrer la cible sous".
|
|
vous
devez posséder le lecteur Quick
Time, afin de pouvoir visionner la vidéo-confidence.
téléchargez-le à l'adresse web suivante : http://www.apple.com/fr/quicktime/download/index.html
|
|
La
génisse et le pythagoricien Je voudrais vous dire les sensations que j'ai éprouvées et que j'ai recueillies auprès de mes amis. Au-delà des métamorphoses, j'ai vu le jeu avec la perméabilité des frontières : celle des deux côtés de la scène (matière inédite à la fois épaisse et aérée) ; celle des espèces avec les hommes-reptiles et celle des genres sexuels avec Clément et Jean-Baptise, superbes images de maternité et de femme trahie. Plus encore que la frontière, le passage de l'inertie à l'animation provoqué par le désir pudique et ardent de Pascal-Pygmalion et incarné par Maud, vamp insaisissable, qui magnifie cette étincelle de vie, ce mirage de l'artiste. La brièveté de son apparition fait d'elle la plus juste Galatée, née du désir de l'homme et aussi vite évanouie que le désir de l'homme, pire, de l'homme-artiste.
Merci
à tous, |